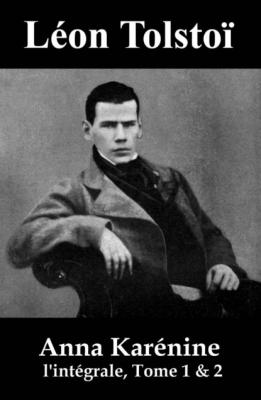Anna Karénine (l'intégrale, Tome 1 & 2). León Tolstoi
Читать онлайн.| Название | Anna Karénine (l'intégrale, Tome 1 & 2) |
|---|---|
| Автор произведения | León Tolstoi |
| Жанр | Языкознание |
| Серия | |
| Издательство | Языкознание |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 4064066373887 |
— Excuse-moi, mais je ne comprends rien à cela; c’est pour moi, comme si, en sortant de dîner, je volais un pain en passant devant une boulangerie.»
Les yeux de Stépane Arcadiévitch brillèrent plus encore que de coutume.
«Pourquoi pas? Le pain frais sent quelquefois si bon qu’on peut ne pas avoir la force de résister à la tentation.
Himmlisch war’s wenn ich bezwang
Meine irdische Begier
Aber wenn mir’s nicht gelang
Hatt! Ich auch ein gross Plaisir.
Et en disant ces vers Oblonsky sourit finement. Levine ne put s’empêcher d’en faire autant.
«Trêve de plaisanteries, continua Oblonsky, suppose une femme charmante, modeste, aimante, qui a tout sacrifié, qu’on sait pauvre et isolée: faut-il l’abandonner, maintenant que le mal est fait? Mettons qu’il soit nécessaire de rompre pour ne pas troubler la vie de famille, mais ne faut-il pas en avoir pitié? Lui adoucir la séparation? Penser à son avenir?
— Pardon, mais tu sais que, pour moi, les femmes se divisent en deux classes, ou, pour mieux dire, il y a des femmes et des… Je n’ai jamais rencontré de belles repenties; mais des créatures comme cette Française du comptoir avec ses frisons me répugnent, et toutes les femmes tombées aussi.
— Et l’Évangile, qu’en fais-tu?
— Laisse-moi tranquille avec ton Évangile. Jamais le Christ n’aurait prononcé ces paroles s’il avait su le mauvais usage qu’on en ferait; c’est tout ce qu’on a retenu de l’Évangile. Au reste je conviens que c’est une impression personnelle, rien de plus. J’ai du dégoût pour les femmes tombées, comme toi pour les araignées; tu n’as pas eu besoin pour cela d’étudier les mœurs des araignées, ni moi celles de ces êtres-là.
— C’est commode de juger ainsi; tu fais comme ce personnage de Dickens, qui jetait de la main gauche par-dessus l’épaule droite toutes les questions embarrassantes. Mais nier un fait n’est pas y répondre. Que faire? Dis-moi, que faire?
— Ne pas voler de pain frais.»
Stépane Arcadiévitch se mit à rire.
«Ô moraliste! Mais comprends donc la situation: voilà deux femmes; l’une se prévaut de ses droits, et ses droits sont ton amour que tu ne peux plus lui donner; l’autre sacrifie tout, et ne demande rien. Que doit-on faire? Comment se conduire? C’est un drame effrayant!
— Si tu veux que je te confesse ce que j’en pense, je te dirai que je ne crois pas au drame; voici pourquoi: selon moi l’amour, les deux amours tels que les caractérise Platon dans son Banquet, tu t’en souviens, servent de pierre de touche aux hommes: les uns ne comprennent qu’un seul de ces amours, les autres ne le comprennent pas. Ceux qui ne comprennent pas l’amour platonique n’ont aucune raison de parler de drame. En peut-il exister dans ces conditions? «Bien obligé pour l’agrément que j’ai eu»: voilà tout le drame. L’amour platonique ne peut en connaître davantage, parce que là tout est clair et pur, parce que…»
À ce moment, Levine se rappela ses propres péchés et les luttes intérieures qu’il avait eu à subir; il ajouta donc d’une façon inattendue:
«Au fait, peut-être as-tu raison. C’est bien possible… Je ne sais rien, absolument rien.
— Vois-tu, dit Stépane Arcadiévitch, tu es un homme tout d’une pièce. C’est ta grande qualité et aussi ton défaut. Parce que ton caractère est ainsi fait, tu voudrais que toute la vie se composât d’événements tout d’une pièce. Ainsi tu méprises le service de l’État parce que tu n’y vois aucune influence sociale utile, et que, selon toi, chaque action devrait répondre à un but précis; tu voudrais que l’amour et la vie conjugale ne fissent qu’un. Tout cela n’existe pas. Et d’ailleurs le charme, la variété, la beauté de la vie tiennent précisément à des nuances.»
Levine soupira sans répondre; il n’écoutait pas, et pensait à ce qui le touchait.
Et soudain ils sentirent tous deux que ce dîner, qui aurait dû les rapprocher, bien que les laissant bons amis, les désintéressait l’un de l’autre; chacun ne pensa plus qu’à ce qui le concernait, et ne s’inquiéta plus de son voisin. Oblonsky connaissait ce phénomène pour en avoir fait plusieurs fois l’expérience après dîner; il savait aussi ce qui lui restait à faire.
«L’addition,» cria-t-il; et il passa dans la salle voisine, où il rencontra un aide de camp de connaissance, avec lequel la conversation s’engagea aussitôt sur une actrice et sur son protecteur. Cette conversation soulagea et reposa Oblonsky de celle qu’il avait eue avec Levine; son ami l’obligeait à une tension d’esprit qui le fatiguait toujours.
Quand le Tatare eut apporté un compte de 28 roubles et des kopecks, sans oublier le pourboire, Levine, qui, en campagnard qu’il était, se serait épouvanté en temps ordinaire de sa part de 14 roubles, n’y fit aucune attention. Il paya et retourna chez lui, pour changer d’habit et se rendre chez les Cherbatzky, où son sort devait se décider.
XII
La jeune princesse Kitty Cherbatzky avait dix-huit ans. Elle paraissait pour la première fois dans le monde cet hiver, et ses succès y étaient plus grands que ceux de ses aînées, plus grands que sa mère elle-même ne s’y était attendue. Sans parler de toute la jeunesse dansante de Moscou qui était plus ou moins éprise de Kitty, il s’était, dès ce premier hiver, présenté deux partis très sérieux: Levine et, aussitôt après son départ, le comte Wronsky.
Les visites fréquentes de Levine et son amour évident pour Kitty avaient été le sujet des premières conversations sérieuses entre le prince et la princesse sur l’avenir de leur fille cadette, conversations qui dégénéraient souvent en discussions très vives. Le prince tenait pour Levine, et disait qu’il ne souhaitait pas de meilleur parti pour Kitty. La princesse, avec l’habitude particulière aux femmes de tourner la question, répondait que Kitty était bien jeune, qu’elle ne montrait pas grande inclination pour Levine, que, d’ailleurs, celui-ci ne semblait pas avoir d’intentions sérieuses…, mais ce n’était pas là le fond de sa pensée. Ce qu’elle ne disait pas, c’est qu’elle espérait un parti plus brillant, que Levine ne lui était pas sympathique et qu’elle ne le comprenait pas; aussi fut-elle ravie lorsqu’il partit inopinément pour la campagne.
«Tu vois que j’avais raison,» dit-elle d’un air triomphant à son mari.
Elle fut encore plus enchantée lorsque Wronsky se mit sur les rangs, et son espoir de marier Kitty non seulement bien, mais brillamment, ne fit que se confirmer.
Pour la princesse, il n’y avait pas de comparaison à établir entre les deux prétendants. Ce qui lui déplaisait en Levine était sa façon brusque et bizarre de juger les choses, sa gaucherie dans le monde, qu’elle attribuait à de l’orgueil, et ce qu’elle appelait sa vie de sauvage à la campagne, absorbé par son bétail et ses paysans. Ce qui lui déplaisait plus encore était que Levine, amoureux de Kitty, eût fréquenté leur maison pendant six semaines de l’air d’un homme qui hésiterait, observerait, et se demanderait si, en se déclarant, l’honneur qu’il leur ferait ne serait pas trop grand. Ne comprenait-il donc pas qu’on est tenu d’expliquer ses intentions lorsqu’on vient assidûment dans une maison où il y a une jeune fille à marier? Et puis ce départ soudain, sans avertir personne?
«Il est heureux, pensait-elle, qu’il soit si peu attrayant et que Kitty ne se soit pas monté la tête.»
Wronsky, par contre, comblait tous ses vœux: il était riche, intelligent, d’une grande famille; une carrière brillante à la cour ou à l’armée s’ouvrait devant lui, et en outre il était charmant. Que pouvait-on rêver de mieux? Il faisait la cour à Kitty au bal, dansait avec elle, s’était fait présenter à ses parents: