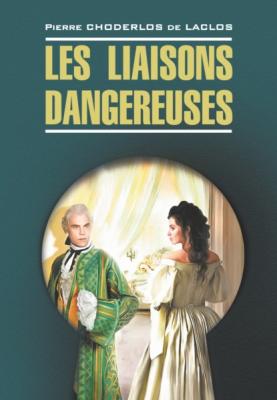Опасные связи / Les liaisons dangereuses. Книга для чтения на французском языке. Пьер Шодерло де Лакло
Читать онлайн.| Название | Опасные связи / Les liaisons dangereuses. Книга для чтения на французском языке |
|---|---|
| Автор произведения | Пьер Шодерло де Лакло |
| Жанр | Иностранные языки |
| Серия | Littérature classique (Каро) |
| Издательство | Иностранные языки |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 978-5-9925-1551-0 |
C’est pourtant pour ce bel objet que vous refusez de m’obéir, que vous vous enterrez dans le tombeau de votre tante, et que vous renoncez à l’aventure la plus délicieuse et la plus faite pour vous faire honneur. Par quelle fatalité faut-il donc que Gercourt garde toujours quelque avantage sur vous ? Tenez, je vous en parle sans humeur : mais, dans ce moment, je suis tentée de croire que vous ne méritez pas votre réputation ; je suis tentée surtout de vous retirer ma confiance. Je ne m’accoutumerai jamais à dire mes secrets à l’amant de Madame de Tourvel.
Sachez pourtant que la petite Volanges a déjà fait tourner une tête. Le jeune Danceny en raffole. Il a chanté avec elle ; et en effet elle chante mieux qu’à une pensionnaire n’appartient. Ils doivent répéter beaucoup de duos, et je crois qu’elle se mettrait volontiers à l’unisson. Mais ce Danceny est un enfant qui perdra son temps à faire l’amour, et ne finira rien. La petite personne de son côté est très farouche ; et, à tout événement, cela sera toujours beaucoup moins plaisant que vous n’auriez pu le rendre : aussi j’ai de l’humeur, et sûrement je querellerai le Chevalier à son arrivée. Je lui conseille d’être doux, car, dans ce moment, il ne m’en coûterait rien de rompre avec lui. Je suis sûre que si j’avais le bon esprit de le quitter à présent, il en serait au désespoir ; et rien ne m’amuse comme un désespoir amoureux. Il m’appellerait perfide, et ce mot de perfide m’a toujours fait plaisir ; c’est, après celui de cruelle, le plus doux à l’oreille d’une femme, et il est moins pénible à mériter. Sérieusement je vais m’occuper de cette rupture. Voilà pourtant de quoi vous êtes cause ! aussi je le mets sur votre conscience. Adieu. Recommandez-moi aux prières de votre Présidente.
Paris, ce 7 août 17**.
Lettre VI. Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil
Il n’est donc point de femme qui n’abuse de l’empire qu’elle a su prendre ! Et vous-même, vous que je nommai si souvent mon indulgente amie, vous cessez enfin de l’être et vous ne craignez pas de m’attaquer dans l’objet de mes affections ! De quels traits vous osez peindre Madame de Tourvel !… quel homme n’eût point payé de sa vie cette insolente audace ? à quelle autre femme qu’à vous n’eût-elle pas valu au moins une noirceur ? De grâce, ne me mettez plus à d’aussi rudes épreuves ; je ne répondrais pas de les soutenir. Au nom de l’amitié, attendez que j’aie eu cette femme, si vous voulez en médire. Ne savez-vous pas que la seule volupté a le droit de détacher le bandeau de l’amour ?
Mais que dis-je ? Madame de Tourvel a-t-elle besoin d’illusion ? non ; pour être adorable il lui suffit d’être elle-même. Vous lui reprochez de se mettre mal ; je le crois bien, toute parure lui nuit ; tout ce qui la cache la dépare. C’est dans l’abandon du négligé qu’elle est vraiment ravissante. Grâce aux chaleurs accablantes que nous éprouvons, un déshabillé de simple toile me laisse voir sa taille ronde et souple. Une seule mousseline couvre sa gorge ; et mes regards furtifs, mais pénétrants, en ont déjà saisi les formes enchanteresses. Sa figure, dites-vous, n’a nulle expression. Et qu’exprimerait-elle, dans les moments où rien ne parle à son cœur ? Non, sans doute, elle n’a point, comme nos femmes coquettes, ce regard menteur qui séduit quelquefois et nous trompe toujours. Elle ne sait pas couvrir le vide d’une phrase par un sourire étudié ; et quoiqu’elle ait les plus belles dents du monde, elle ne rit que de ce qui l’amuse. Mais il faut voir comme, dans les folâtres jeux, elle offre l’image d’une gaîté naïve et franche ! comme, auprès d’un malheureux qu’elle s’empresse de secourir, son regard annonce la joie pure et la bonté compâtissante ! Il faut voir, surtout au moindre mot d’éloge ou de cajolerie, se peindre, sur sa figure céleste, ce touchant embarras d’une modestie qui n’est point jouée. Elle est prude et dévote, et de là vous la jugez froide et inanimée. Je pense bien différemment. Quelle étonnante sensibilité ne faut-il pas avoir pour la répandre jusque sur son mari, et pour aimer toujours un être toujours absent ! Quelle preuve plus forte pourriez-vous désirer ? J’ai su pourtant m’en procurer une autre.
J’ai dirigé sa promenade de manière qu’il s’est trouvé un fossé à franchir ; et, quoique fort leste, elle est encore plus timide : vous jugez bien qu’une prude craint de sauter le fossé[7]. Il a fallu se confier à moi. J’ai tenu dans mes bras cette femme modeste. Nos préparatifs et le passage de ma vieille tante avaient fait rire aux éclats la folâtre dévote : mais dès que je me fus emparé d’elle, par une adroite gaucherie, nos bras s’entrelacèrent mutuellement. Je pressai son sein contre le mien ; et, dans ce court intervalle, je sentis son cœur battre plus vite. L’aimable rougeur vint colorer son visage, et son modeste embarras m’apprit assez que son cœur avait palpité d’amour et non de crainte. Ma tante, cependant, s’y trompa comme vous et se mit à dire : « L’enfant a eu peur ; » mais la charmante candeur de l’enfant ne lui permit pas le mensonge, et elle répondit naïvement : « Oh non, mais… » Ce seul mot m’a éclairé. Dès ce moment, le doux espoir a remplacé la cruelle inquiétude. J’aurai cette femme ; je l’enlèverai au mari qui la profane : j’oserai la ravir au Dieu même qu’elle adore. Quel délice d’être tour à tour l’objet et le vainqueur de ses remords ! Loin de moi l’idée de détruire les préjugés qui l’assiègent ! ils ajouteront à mon bonheur et à ma gloire. Qu’elle croie à la vertu, mais qu’elle me la sacrifie ; que ses fautes l’épouvantent sans pouvoir l’arrêter, et, qu’agitée de mille terreurs, elle ne puisse les oublier, les vaincre que dans mes bras. Qu’alors, j’y consens, elle me dise : « Je t’adore » ; elle seule, entre toutes les femmes, sera digne de prononcer ce mot. Je serai vraiment le dieu qu’elle aura préféré.
Soyons de bonne foi ; dans nos arrangements, aussi froids que faciles, ce que nous appelons bonheur est à peine un plaisir. Vous le dirai-je ? je croyais mon cœur flétri ; et ne me trouvant plus que des sens, je me plaignais d’une vieillesse prématurée. Mme de Tourvel m’a rendu les charmantes illusions de la jeunesse. Auprès d’elle je n’ai pas besoin de jouir pour être heureux. La seule chose qui m’effraie est le temps que va me prendre cette aventure ; car je n’ose rien donner au hasard. J’ai beau me rappeler mes heureuses témérités, je ne puis me résoudre à les mettre en usage. Pour que je sois vraiment heureux, il faut qu’elle se donne ; et ce n’est pas une petite affaire.
Je suis sûr que vous admireriez ma prudence. Je n’ai pas encore prononcé le mot d’amour ; mais déjà nous en sommes à ceux de confiance et d’intérêt. Pour la tromper le moins possible, et surtout pour prévenir l’effet des propos qui pourraient lui revenir, je lui ai raconté moi-même, et comme en m’accusant, quelques-uns de mes traits les plus connus. Vous ririez de voir avec quelle candeur elle me prêche. Elle veut, dit-elle, me convertir. Elle ne se doute pas encore de ce qu’il lui en coûtera pour le tenter. Elle est loin de penser qu’en plaidant, pour parler comme elle, pour les infortunées que j’ai perdues, elle parle d’avance dans sa propre cause. Cette idée me vint hier au milieu d’un de ses sermons, et je ne pus me refuser au plaisir de l’interrompre, pour l’assurer qu’elle parlait comme un prophète. Adieu, ma très belle amie. Vous voyez que je ne suis pas perdu sans ressource.
P. S. À propos, ce pauvre Chevalier s’est-il tué de désespoir ? En vérité, vous êtes cent fois plus mauvais sujet que moi, et vous m’humilieriez, si j’avais de l’amour-propre.
Du château de…, ce 9 août 17**.
Lettre VII. Cécile Volanges à Sophie Carnay[8]
Si je ne t’ai rien dit de mon mariage, c’est que je ne suis pas plus instruite que le premier jour. Je m’accoutume à n’y plus penser, et je me trouve assez bien de mon genre de vie. J’étudie beaucoup mon chant et ma harpe ; il me semble que je les aime mieux depuis que je n’ai plus de maître
On reconnaît ici le mauvais goût des calembours qui commençait à prendre et qui, depuis a fait tant de progrès.
Pour ne pas abuser de la patience du lecteur, on supprime beaucoup de lettres de cette correspondance journalière ; on ne donne que celles qui ont paru nécessaires à l'intelligence des événements de cette société. C'est par le même motif qu'on supprime aussi toutes les lettres de Sophie Carnay, et plusieurs de celles des acteurs de ces aventures.