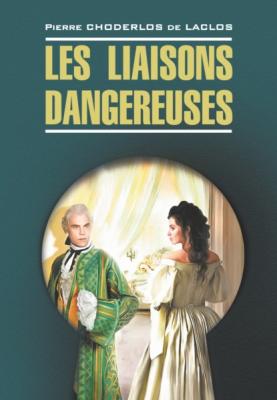Опасные связи / Les liaisons dangereuses. Книга для чтения на французском языке. Пьер Шодерло де Лакло
Читать онлайн.| Название | Опасные связи / Les liaisons dangereuses. Книга для чтения на французском языке |
|---|---|
| Автор произведения | Пьер Шодерло де Лакло |
| Жанр | Иностранные языки |
| Серия | Littérature classique (Каро) |
| Издательство | Иностранные языки |
| Год выпуска | 0 |
| isbn | 978-5-9925-1551-0 |
Quoiqu’il en soit, un avocat vous dirait que le principe ne s’applique pas à la question. En effet, vous supposez que j’ai le choix entre écrire et parler, ce qui n’est pas. Depuis l’affaire du 19, mon inhumaine, qui se tient sur la défensive, a mis à éviter les rencontres une adresse qui a déconcerté la mienne. C’est au point que, si cela continue, elle me forcera à m’occuper sérieusement d’en trouver les moyens : car assurément je ne souffrirai d’être vaincu par elle en aucun genre. Mes lettres mêmes sont le sujet d’une petite guerre : non contente de n’y pas répondre, elle refuse de les recevoir. Il faut pour chacune une ruse nouvelle, et qui ne réussit pas toujours.
Vous vous rappelez par quel moyen simple j’avais remis la première ; la seconde n’offrit pas plus de difficulté. Elle m’avait demandé de lui rendre sa lettre : je lui donnai la mienne en place, sans qu’elle eût le moindre soupçon. Mais soit dépit d’avoir été attrapée, soit caprice, ou enfin soit vertu, car elle me forcera d’y croire, elle refusa obstinément la troisième. J’espère pourtant que l’embarras où a pensé la mettre la suite de ce refus, la corrigera pour l’avenir.
Je ne fus pas très étonné qu’elle ne voulût pas recevoir cette lettre, que je lui offrais tout simplement ; c’eût été déjà accorder quelque chose, et je m’attends à une plus longue défense. Après cette tentative, qui n’était qu’un essai fait en passant, je mis une enveloppe à ma lettre ; et prenant le moment de la toilette, où Mme de Rosemonde et la femme de chambre étaient présentes, je la lui envoyai par mon chasseur, avec ordre de lui dire que c’était le papier qu’elle m’avait demandé. J’avais bien deviné qu’elle craindrait l’explication scandaleuse que nécessiterait un refus : en effet, elle prit la lettre ; et mon ambassadeur, qui avait ordre d’observer sa figure, et qui ne voit pas mal, n’aperçut qu’une légère rougeur et plus d’embarras que de colère.
Je me félicitais donc : bien sûr, ou qu’elle garderait cette lettre, ou que si elle voulait me la rendre, il faudrait qu’elle se trouvât seule avec moi, ce qui me donnerait une occasion de lui parler. Environ une heure après, un de ses gens entre dans ma chambre et me remet, de la part de sa maîtresse, un paquet d’une autre forme que le mien, et sur l’enveloppe duquel je reconnais l’écriture tant désirée. J’ouvre avec précipitation. C’était ma lettre elle-même, non décachetée et pliée seulement en deux. Je soupçonne que la crainte que je ne fusse moins scrupuleux qu’elle sur le scandale, lui a fait employer cette ruse diabolique.
Vous me connaissez ; je n’ai pas besoin de vous peindre ma fureur. Il fallut pourtant reprendre son sang-froid, et chercher de nouveaux moyens. Voici le seul que je trouvai.
On va d’ici, tous les matins, chercher les lettres à la poste, qui est environ à trois quarts de lieue : on se sert, pour cet objet, d’une boîte couverte à peu près comme un tronc, dont le maître de la poste a une clef et Mme de Rosemonde l’autre. Chacun y met ses lettres dans la journée, quand bon lui semble : on les porte le soir à la poste, et le matin on va chercher celles qui sont arrivées. Tous les gens, étrangers ou autres, font ce service également. Ce n’était pas le tour de mon domestique ; mais il se chargea d’y aller, sous le prétexte qu’il avait affaire de ce côté.
Cependant j’écrivis ma lettre. Je déguisai mon écriture pour l’adresse, et je contrefis assez bien, sur l’enveloppe, le timbre de Dijon. Je choisis cette ville, parce que je trouvai plus gai, puisque je demandais les mêmes droits que le mari, d’écrire aussi du même lieu ; et aussi parce que ma belle avait parlé toute la journée du désir qu’elle avait de recevoir des lettres de Dijon. Il me parut juste de lui procurer ce plaisir.
Ces précautions une fois prises, il était facile de faire joindre cette lettre aux autres. Je gagnais encore à cet expédient d’être témoin de la réception : car l’usage est ici de se rassembler pour déjeuner, et d’attendre l’arrivée des lettres avant de se séparer. Enfin elles arrivèrent.
Mme de Rosemonde ouvrit la boîte. « De Dijon », dit-elle, en donnant la lettre à Madame de Tourvel. – « Ce n’est pas l’écriture de mon mari », reprit celle-ci d’une voix inquiète, en rompant le cachet avec vivacité ; le premier coup d’œil l’instruisit ; et il se fit une telle révolution sur sa figure, que Mme de Rosemonde s’en aperçut, et lui dit : « Qu’avez-vous ? » Je m’approchai aussi, en disant : « Cette lettre est donc bien terrible ? » La timide dévote n’osait lever les yeux, ne disait mot, et, pour sauver son embarras, feignait de parcourir l’épître, qu’elle n’était guère en état de lire. Je jouissais de son trouble ; et n’étant pas fâché de la pousser un peu : « Votre air plus tranquille, ajoutai-je, fait espérer que cette lettre vous a causé plus d’étonnement que de douleur. » La colère alors l’inspira mieux que n’eût pu faire la prudence. « Elle contient, répondit-elle, des choses qui m’offensent, et que je suis étonnée qu’on ait osé m’écrire. » « Et qui donc ? » interrompit Mme de Rosemonde. « Elle n’est pas signée, » répliqua la belle courroucée : « Mais la lettre et son auteur m’inspirent un égal mépris. On m’obligera de ne m’en plus parler. » En disant ces mots, elle déchira l’audacieuse missive, en mit les morceaux dans sa poche, se leva et sortit.
Malgré cette colère, elle n’en a pas moins eu ma lettre ; et je m’en remets bien à sa curiosité, du soin de l’avoir lue en entier.
Le détail du reste de la journée me mènerait trop loin. Je joins à ce récit le brouillon de mes deux lettres ; vous serez aussi instruite que moi. Si vous voulez être au courant de cette correspondance, il faut vous accoutumer à déchiffrer mes minutes : car pour rien au monde, je ne dévorerais l’ennui de les recopier. Adieu, ma belle amie.
De …, ce 25 août 17**.
Lettre XXXV. Le Vicomte de Valmont à la Présidente de Tourvel
Il faut vous obéir, Madame ; il faut vous prouver qu’au milieu des torts que vous vous plaisez à me croire, il me reste au moins assez de délicatesse pour ne pas me permettre un reproche, et assez de courage pour m’imposer les plus douloureux sacrifices. Vous m’ordonnez le silence et l’oubli ! eh bien ! je forcerai mon amour à se taire ; et j’oublierai, s’il est possible, la façon cruelle dont vous l’avez accueilli. Sans doute, le désir de vous plaire n’en donnait pas le droit ; et j’avoue encore que le besoin que j’avais de votre indulgence, ne faisait pas un titre pour y prétendre : mais vous regardez mon amour comme un outrage ; vous oubliez que si ce pouvait être un tort, vous en seriez à la fois et la cause et l’excuse. Vous oubliez aussi, qu’accoutumé à vous ouvrir mon âme, lors même que cette confiance pouvait me nuire, il ne m’était plus possible de vous cacher les sentiments dont vous l’avez pénétrée ; et ce qui fut l’ouvrage de ma bonne foi, vous le regardez comme le fruit de l’audace. Pour prix de l’amour le plus tendre, le plus vrai, le plus respectueux, vous me rejettez loin de vous. Vous me parlez enfin de votre haine. Quel autre ne se plaindrait pas d’être traité ainsi ? Moi seul, je me soumets ; je souffre tout et ne murmure point ; vous frappez, et j’adore. L’inconcevable empire que vous avez sur moi vous rend maîtresse absolue de mes sentiments ; et si mon amour seul vous résiste, si vous ne pouvez le détruire, c’est qu’il est votre ouvrage et non pas le mien.
Je ne demande point un retour dont jamais je ne me suis flatté. Je n’attends pas même cette pitié, que l’intérêt que vous m’aviez témoigné quelquefois pouvait me faire espérer. Mais je crois, je l’avoue, pouvoir réclamer votre justice.
Vous m’apprenez, Madame, qu’on a cherché à me nuire dans votre esprit. Si vous en eussiez cru les conseils